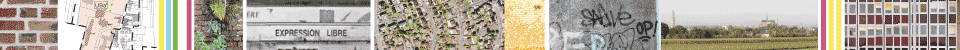Participation à l’enquête publique pour la création d’une centrale photovoltaïque à Amiens, septembre 2020.
Le projet vise à installer une centrale photovoltaïque au sol à Amiens, sur le site d’une ancienne carrière de craie. Le site en friche représente une surface clôturée d’environ 18 hectares, dont 4,4 hectares seront occupés par des panneaux solaires. Le projet sera directement accolé au cimetière de la Madeleine, classé aux monuments historiques.
Mes remarques portent notamment:
• sur l’impact de l’installation de ruches, qui n’est pas nécessairement favorable à la biodiversité,
• sur la gestion de la végétation par pâturage, potentiellement contraire à certains enjeux de préservation,
• sur la marge de progrès sous-estimée dans les communications pour atteindre une autonomie énergétique en 2050, ambition affichée par la Métropole.
à Monsieur Erich Leclercq,
Commissaire-Enquêteur
Rivery, le 2 septembre 2020
Objet : Contribution à l’enquête publique portant sur le projet de centrale photovoltaïque à Amiens
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Le projet, tel qu’il est présenté, ajusté pour tenir compte des intérêts écologiques du site, sous réserve d’obtenir la dérogation de destruction d’espèces protégées et de mettre en oeuvre toutes les mesures avancées, a mon soutien d’habitant de la Métropole.
Toutefois, je relève plusieurs aspects du projet, du dossier d’étude d’impacts et des discours accompagnant le projet, qui mériteraient d’être encore précisés.
1. Précisions sur le cimetière de la Madeleine, classé Monument historique
En p.76 de l’état initial, le périmètre des abords de l’ensemble classé n’est pas correct. Il ne s’étend pas à 500m comme mentionné en p.79 (sources: PLU d’Amiens et http://atlas.patrimoines.culture.fr). Il n’englobe pas « en grande partie la zone d’implantation potentielle du projet », mais s’étend en revanche plus loin dans les rues Gutemberg, Saint-Maurice et Chemin de Vauvoix. L’importance patrimoniale du site, mitoyen au projet, mérite ces précisions. Toutefois, elles ne semblent pas impliquer de réviser sensiblement l’analyse des impacts du projet.
2. Responsabilité de la mise en œuvre des mesures
Qui portera la responsabilité de la gestion du site et de la mise en oeuvre des mesures, en phase travaux, en phase d’exploitation et lors du démantèlement: Total Quadran / CS Vauvoix, pétitionnaire, ou Amiens Métropole, propriétaire du site et communicant sur le projet?
Par ailleurs, le dossier ne précise pas si l’ensemble des recommandations et injonctions faite par l’écologue au gestionnaire (du type « la clôture mise en place devra être semi-perméable », p.247, Chap. F) sont considérées comme autant de mesures que ce dernier s’engage à mettre en œuvre. Cela semble implicite mais mériterait d’être écrit. L’emploi du futur (du type « la clôture mise en place sera semi-perméable ») serait plus explicite. En effet, le développement des mesures dans une étude d’impact ne doit pas constituer un recueil de recommandations ou d’injonctions émises par des experts à destination d’un porteur de projet, mais doivent être traduites en engagements du porteur de projet à destination du public et des services de l’état.
3. Impact du pâturage
Le dossier mentionne le pâturage comme solution possible pour l’entretien de la végétation aux abords des installations. Amiens Métropole en fait un argument de promotion du projet.
Toutefois, le dossier ne précise pas si ce pâturage s’étendra aux parties du site où la végétation actuelle est maintenue pour son intérêt écologique. Si le pâturage s’étend à tout le site, le dossier n’en détaille pas l’impact sur les milieux préservés. Si non, le dossier ne précise pas le moyen de le limiter, par exemple par l’installation d’une clôture interne.
Par ailleurs, le pâturage semble incompatible avec une fauche « tardive », « exportatrice » et « différenciée » comme recommandé en mesure A1.
4. Impact de l’installation de ruches
L’étude d’impact ne développe pas l’annonce d’Amiens Métropole d’installer des ruches sur le site (p.156, chap. D). Certes, l’abeille mellifère Apis mellifera n’est pas une espèce protégée. Toutefois, sa variété locale, sauvage, dont la diversité génétique s’est adaptée par évolution naturelle aux conditions environnementales locales, Apis mellifera mellifera, l’abeille noire, est menacée. Elle souffre essentiellement de l’utilisation de variétés sélectionnées par l’homme pour la production de miel (variétés italienne, Buckfast, etc.), avec lesquelles elle se croise. Pour la biodiversité, il serait aberrant de substituer aux sangliers de nos campagnes nos porcs roses d’élevage, ou aux loups alpins des populations de caniches, appartenant aux mêmes espèces, mais dont les variétés sélectionnées ont perdu leur capacité d’adaptation. Cette substitution s’opère pourtant à grande échelle avec les abeilles d’élevage aux dépens de l’abeille noire. Ainsi, afin de limiter l’impact de cette installation de ruches sur ce qu’il reste de richesse génétique des abeilles mellifères sauvages, il serait nécessaire que la Métropole s’engage à ne peupler ses ruches que d’abeilles noires locales.
Par ailleurs, l’intérêt des ruches réside d’abord dans l’image positive qu’elles renvoient au public. En effet, l’intérêt de leur multiplication n’est pas une évidence pour les équilibres écologiques, fussent-elles peuplées d’abeilles noires. En particulier, la concentration de ruches, déjà nombreuses à Amiens, peut affaiblir les populations des autres espèces butineuses locales par concurrence pour l’exploitation des ressources forales. En pratique, pour les abeilles et la biodiversité en général, la première mesure à prendre est le maintien et le développement de milieux sauvages, avec une fore locale.
5. Production annuelle, ambition amiénoise, et développement soutenable
Le projet est présenté par Amiens Métropole comme élément de réponse à son ambition affichée d’une autonomie énergétique à l’horizon 2050 (p.156, chap. D). Pourtant, le projet ne produira que l’électricité consommée par près de 10.000 habitants. Sachant que l’électricité représente le quart des consommations d’énergie (source ministère en charge de l’énergie, 2015), que la part du chauffage n’est pas prise en compte, et que la consommation d’électricité « résidentielle » représente près du tiers de la consommation d’électricité totale en France (source RTE, 2017), on peut estimer que le projet produira moins de 0,5% de l’énergie totale consommée par les 200.000 habitants et les activités de la Métropole (10/200 * 1/4 * 1/3 * 100). La marge de progression ne doit pas être négligée dans les communications, afin que chacun puisse mesurer en responsabilité l’ampleur de l’effort qu’il reste à faire. « Réduire de 62% les consommations » et « multiplier par 7 » ces initiatives de production d’énergie renouvelables, comme annoncé par la Métropole, sera très insuffisant pour atteindre l’autonomie énergétique posée comme ambition.
Par ailleurs, le projet occupe l’un des rares sites propices du territoire, où il n’induira ni perte d’espaces agricoles ni impact sensible sur la biodiversité. Ce modèle de centrale au sol semble donc peu reproductible à Amiens. Comme élément de comparaison, en termes de prélèvement d’emprise, le productible annuel attendu pour l’ensemble du projet (9788 MWh, sur 12 hectares) équivaut à celui d’une seule éolienne de 4,5MW fonctionnant en équivalent pleine puissance un quart du temps (4,5 * 365 * 24 ÷ 4 = 9855 MWh), sur une emprise totale moyenne de 0,3 hectare (ratios ordinairement retenus pour une éolienne actuelle).
De manière plus globale, la transition énergétique, essentielle, n’a de sens qu’accompagnée d’un questionnement sur la pertinence du « développement » expansif, contradictoire, que met encore en œuvre, comme trop d’autres, Amiens Métropole.
—
Espérant que les décisions de la Métropole tendront au plus tôt vers un modèle de développement sincèrement durable, en termes d’artificialisation des terres, de neutralité carbone et de développement de la biodiversité notamment, je vous prie de bien vouloir tenir compte de ces remarques.
Cordialement,
David Bonduelle,
Habitant de Rivery