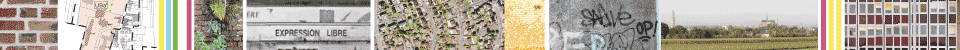Les discours en faveur de la biodiversité sont souvent brouillés par le parachutage de l’idée qu’il serait nécessaire, pour la biodiversité, de protéger aussi les variétés domestiques et cultivées.
Que telle vigne, telle pomme ou tel cochon puisse avoir un intérêt comme élément de patrimoine culturel, je veux bien le concevoir, ne vous méprenez pas. Mais l’urgence des mesures en faveur de la biodiversité réside dans la stabilité des écosystèmes, dont dépendent les équilibres de notre planète. Or, les variétés sélectionnées par l’homme s’inscrivent en dehors des écosystème.

En effet, la biodiversité s’observe d’abord à l’échelle des gènes, dont la diversité est héritée des mutations ordinaires, transmises au fil des générations au sein de populations suffisamment nombreuses et brassées.
La stabilité qui découle de ces échanges provient des capacités d’adaptation des populations. Cette capacité d’adaptation vient de l’avantage procuré par certains gènes, portés par une partie des individus, face aux modifications de l’environnement. Les colonies d’abeilles qui résistent le plus au froid survivent plus nombreuses aux hivers rigoureux. Les plantes les plus rases survivent mieux à l’arrivée d’animaux brouteurs. Les frênes les plus résistants à la chalarose pourront probablement pallier, au niveau des populations de frênes, la mort des individus les plus sensibles.

À l’inverse, les variétés sélectionnées par l’homme n’évoluent plus en réponse adaptative aux modifications de leur environnement. Elles présentent généralement une faible diversité génétique entre individus au sein même de chaque variété. Cette faible diversité génétique est d’ailleurs recherchée pour parvenir à reproduire le plus fidèlement possible les caractères propres de ces variétés. Que ce soit par reproduction végétative (greffes, boutures, marcottage…), par reproduction sexuée maîtrisée (production de semences fidèles) pour les plantes, ou par fécondation dirigée voire par clonage parfois pour les animaux.
Ces variétés cultivées ou domestiques n’ont plus leur pleine capacité à s’adapter à des évolutions d’environnement, mais ça n’a pas vraiment d’importance dès lors que l’on n’attend pas d’elles une perpétuation spontanée.
Ces variétés cultivées, tout comme les espèces exotiques qu’elles sont souvent initialement (poules, poires, potiron…), ne répondent pas non plus de manière optimale aux besoins des autres espèces, sauvages et locales. Mais comme elles n’ont normalement pas vocation à être introduites dans les écosystèmes, ça n’a pas non plus de grande importance.
Le problème, c’est que l’on évoque souvent ces variétés domestiques comme facteurs de restauration d’une biodiversité déclinante.
Certes, j’admire les passionnés qui perpétuent telle variété de potiron vert, sucré, à la peau cloquée, sélectionnée patiemment en 1700 par un aïeul. Ou tel rosier. Ou telle poule. Mais de ces variétés de potiron, de rosier et de poule, à préserver sûrement comme éléments du patrimoine culturel de notre humanité, les écosystèmes s’en fichent complètement.

Alors j’ai parcouru le « Plan Biodiversité », de juillet 2018, pour y puiser quelques arguments. Notez au passage l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Ambitieux. Bien que… pour inverser une tendance, il ne faut pas seulement cesser de faire pire, il faudrait aussi faire mieux.

Concernant les variétés cultivées, ma pêche d’arguments a révélé que notre administration entretient elle aussi une confusion. Je lis en page 17:
« 3.4 promouvoir la diversité génétique
La diversité génétique est souvent oubliée par les politiques publiques dédiées à la biodiversité. Néanmoins, cette diversité est indispensable pour préserver l’adaptabilité du vivant aux conditions de vies futures. C’est parce qu’il existe un patrimoine génétique vaste et riche que les espèces ont pu trouver des solutions originales face aux bouleversements passés. Cette richesse leur sera indispensable pour faire face aux changements à venir.
Le plan biodiversité vise à renforcer la prise en compte de la diversité génétique, notamment pour les espèces utilisées en agriculture et dans les potagers. »
[Action 52] Nous encouragerons la protection et la promotion des semences de variétés
anciennes, aussi bien destinées à des usages amateurs que professionnels. Par ailleurs, nous faciliterons la commercialisation de variétés anciennes pour les usages non professionnels.
[Action 53] Nous encouragerons la protection et la promotion des races patrimoniales. Par ailleurs, nous favoriserons le maintien de la diversité génétique intraraciale des ressources génétiques animales françaises. »
Et c’est tout! Pour promouvoir la biodiversité génétique, le Plan propose de soutenir les variétés domestiques sélectionnée!
Heureusement, dans le fond, par les mesures visant à protéger ou recréer des milieux naturels et favoriser les connexions entre eux, le Plan va bien dans le sens de protéger la biodiversité génétique des populations sauvages. Le titre 3.4 et le constat sont bons. Mais les solutions destinées in fine à la stabilité des écosystèmes par la diversité génétique sont ailleurs dans le Plan. Les mesures de conservation du patrimoine culturel et visant à avoir du bétail pas trop fragile n’ont rien à voir, et entretiennent la confusion.
Confusion transmises par d’autres discours, vantant encore le libre échange de semences de légumes anciens ou la plantation de fruitiers sélectionnés localement, comme autant de mesures en faveur de la biodiversité.
Les mesures de conservation du patrimoine culturel sont louables en tant que telles. Mais nos écosystèmes restent les incompris de l’histoire, et peut-être, encore pour quelques temps, les perdants.
.
..
.