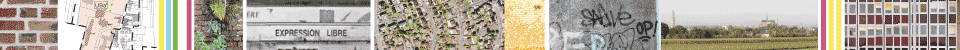Été 2019 – Participation au MOOC Villes et territoires durables, proposé par l’ADEME
En ce début d’été, l’Ademe a proposé un cours en ligne sur l’urbanisme durable, décliné en 3 séquences: Urbanisme durable, de quoi parle-t-on ? Comment inscrire la durabilité dans les projets de planification et d’aménagement ? Quels seront les sujets émergents de la ville et des territoires de demain ?
En clôture, l’équipe pédagogique a proposé cette discussion : Si vous deviez imaginer votre ville durable du futur… Comment serait-elle ? La discussion se base sur cette illustration de ville à commenter.

Je reprends ici mes 2 contributions à l’exercice, l’une directement liée à l’image, l’autre plus générale sur la pertinence des propositions notamment au regard de ce que les autres participants ont exprimé. Ces 2 contributions faites dans le cadre de l’échange proposé sont bien-sûr ouvertes aux critiques et à la contradiction.
Bonjour à tous,
Voici quelques éléments de discussion basés sur l’illustration proposée.
• Ruches en ville
Mettre des ruches en ville n’apporte rien en termes de biodiversité. Quelques espèces végétales sont certes davantage pollinisées, les aidant à prospérer.
En revanche, les abeilles domestiques, qui ne concernent qu’une seule espèce:
- ne favorisent que certaines espèces de flore, souvent une espèce unique lors des pics de floraison, au détriment des autres,
- peuvent entrer en concurrence avec le millier d’espèces d’abeilles sauvages,
- dans les ruches, sont souvent issues de souches sélectionnées au détriment des variétés de l’abeille domestique noire locale qu’elles font disparaître,
- sont mises en avant dans la communication des villes au détriment d’autres actions qui seraient, elles, efficaces pour la biodiversité.
Pour soutenir un développement de la biodiversité, il est nécessaire de créer une grande variété d’habitats, sur tous les supports possible (toitures, façades, noues, stationnements, berges etc.), et de soutenir le développement d’une flore locale variée.
• Diversité des végétaux plantés et espèces locales
En milieu urbain ce sont souvent des essences non locales qui sont plantées, comme ici ce qui ressemble à des cyprès, pour l’esthétique, leur résistance aux polluants, leur ombrage, leur inconvénient réduit relatif à la chute de fruits ou de feuilles, leur caractère non allergisant… Or, la biodiversité est héritée d’une longue coévolution entre espèces de faune et de flore, adaptées aux conditions locales de l’environnement. Bref, des espèces exotiques contribuent peu à la biodiversité.
Pour soutenir un développement de la biodiversité, il est nécessaire de ne recourir qu’à des espèces locales, si possible non « clonées », c’est-à-dire issues d’une reproduction sexuée afin d’avoir une variété de patrimoines génétiques, et mieux encore de développer des espaces de nature spontanée, et supprimer activement tout espèce exotique envahissante (buddléia, renouée du japon etc).
• Petit éolien
En milieu urbain, les vents ne sont pas adaptés à leur exploitation (faibles et turbulents). Par ailleurs, les petites machines sont les moins rentables énergétiquement.
• Volumes des lieux de vie
L’illustration montre des locaux de travail surdimensionnés. Dimensionner correctement les lieux de vie à leurs usages évite des dépenses inutiles de matériaux, d’emprise, de chauffage et de climatisation, de transports…
• Moyens de transport
Voiture individuelle ou vélo? Choix cornélien entre temps de route, météo et frustration écologique et musculaire. Pour concilier le confort de la voiture (protection contre les intempéries, vitesse de trajet) et la contribution des mollets, il existe hors Europe des vélos électriques carrénés sans bridage, que la réglementation devrait pouvoir autoriser aussi dans nos villes.
• Surfaces des toitures
L’étalement urbain est notamment une question de ressource en espaces. Or, les toitures sont des emprises inutilement désertes.
Le photovoltaïque et les techniques de végétalisation des toitures ayant bien progressé ces dernières années, on ne devrait plus voir un seul toit inutilisé!
• Minéralisation des espaces / cours d’eau canalisé
Comme vu plus haut, tous les espaces dont l’imperméabilisation ne se justifie pas devraient être végétalisés.
Tant que possible, les fonctionnalités écologiques des berges des cours d’eau canalisés devraient être restaurées.
• SCOT et autres documents de planification vs. capacité politique locale
Seules 10% des villes en France font plus de 3500 habitants. Or, avec 3500 habitants :
- les élus ne sont pas nécessairement connaisseurs des grands enjeux environnementaux et des réponses à mettre en oeuvre dans les aménagements,
- les électeurs n’ont pas beaucoup de choix, donc d’influence par leur vote pour choisir des élus éclairés.
Pour leurs aménagements, les élus d’une grande majorité des villes ne se réfèrent quand il existe qu’à leur PLU, qui n’a de rapport au SCoT qu’une absence de contradiction. La grande majorité des élus n’ont pas de connaissance des grandes ambitions des SRADDET et autres documents intégrés aux SCoT, ni des SCoT eux-mêmes, qui pourtant visent à être pertinents sur les réponses à apporter localement. On a donc d’un côté des documents de planification très travaillés, souvent pertinents et ambitieux, exposant un monde idéal et que leurs rédacteurs peuvent ensuite contempler satisfaits, et de l’autre des aménagements improvisés sans cohérence avec ces documents de référence qui, de fait sont tout à fait inutiles.
Il est nécessaire, pour progresser dans le développement de villes durables, de créer des liens plus forts entre planification et mise en oeuvre. Par obligation de conformité entre PLU et SCoT? Par des formations des élus locaux?
Créatif ou pragmatique?
La participation du public, à laquelle s’apparente cet exercice, est importante notamment pour faire émerger de nouvelles idées, comme le disait un intervenant. Je note ici toutefois 2 limites à cette mise à contribution, dont il est nécessaire de tenir compte pour proposer des aménagements pertinents.
1 – D’abord, de nombreuses pistes d’aménagements durables existent déjà, ont déjà été éprouvées, ou au contraire n’ont pas été concluantes, quand leur inutilité ou leurs effets négatifs n’ont pas été démontrés par des acteurs éclairés.
Les documents « outils » de planification (SDAGE, SRADDET, SRCE…), ou encore les guides techniques (CAUE, ARB Ile-de-France, Ademe, etc.), élaborés avec des spécialistes, constituent en outre des références qui devraient être incontournables.
Or, l’expérience et les documents de référence sont souvent méconnus de nous, mais aussi de nos élus, sauf probablement dans les grandes villes qui recèlent quelques compétences. Laisser libre cours à chacun, même avec la meilleure volonté du monde, pour proposer et faire ce qui nous semble bon est très courant, mais souvent aussi regrettable.
Le développement en ville de l’apiculture ou de l’éolien sont des exemples d’actions globalement peu pertinentes donnés par l’illustration, perpétués du fait de leur image ressentie positivement. La végétalisation par des espèces non locales et peu variées, présentée ensuite comme une composante de trame verte relève aussi d’une méconnaissance de ce qui soutient la biodiversité. Le recours à un réseau enterré pour la gestion des eaux pluviales quand un simple espace végétalisé suffit relève d’un « bon sens« dépassé.
2 – Ensuite, pour toute consultation publique, on relève une multitude de destinataires possibles des propositions émises. Cela me semble particulièrement vrai en matière d’urbanisme durable, qui découle d’une multitude de thématiques, qui ne dépendent pas d’un unique acteur. Si bien que les propositions les plus pertinentes peuvent se perdre dans le désert.
Les mairies de bonne volonté peuvent certes tenter des aiguillages, solliciter les aménageurs, revoir leurs PLU, communiquer auprès de chacun sur les bonnes pratiques.
Mais y a-t-il quelqu’un pour faire suivre des demandes de modifications réglementaires en matière de transports ou de monuments historiques? Qui solliciter pour aider le développement d’une agriculture maraîchère de proximité? Comment assurer à un commerce de proximité la viabilité nécessaire à son installation?
Et comment s’adresser directement aux particuliers, pour les propositions qui les concernent? Supprimez votre allée bétonnée, remplacez vos thuyas, gérez vos eaux pluviales! Chacun de nous fait souvent au plus simple et au moins cher, tant que ce n’est pas illégal, ou au moins que ce n’est pas sanctionné. Ces propositions demandent implicitement d’intégrer plus d’obligations environnementales aux PLU, et de renforcer les contrôles voire les sanctions pour être appliquées. Dit comme ça, je ne suis pas sûr d’être très écouté.
–
Bref, en conséquence, pour une ville durable, je serais plus pragmatique que créatif… Il est nécessaire de s’approprier les ressources et expériences déjà disponibles avant d’élaborer un projet. Ensuite, si l’on fait participer le public, il faut être prêt à relayer des demandes variées, et à y répondre par des mesures qui ne plairont pas à tous.
Note : le texte en vert correspond à des retouches de forme du texte.