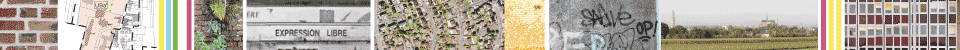Pour nous inciter à mieux gérer nos déchets, nous sommes mis au défi du « zéro déchet ». Un « zéro déchet » simpliste et trompeur.
Pour commencer, de quoi parle-t-on?
Aucune définition du « déchet », notamment la définition du Code de l’Environnement « tout bien meuble destiné à l’abandon » [1], n’est vraiment satisfaisante.
Ces biens meubles que l’on destine à l’abandon, c’est a priori tout ce que l’on met dans nos poubelles. Y compris la poubelle des recyclables. C’est aussi ce que l’on met en déchèterie ou que l’on donne pour se débarrasser. Ou dont on se débarrasse de toute autre manière.
Or, outre ces biens meubles, nous devrions aussi considérer comme déchets les gaz émis par nos activités, comme le CO2 émis par les moteurs et les chaudières, que l’on produit mais dont on se débarrasse; les rejets liquides, comme nos pipis et nos savons reçus par les stations d’épuration; nos déchets radioactifs, qui nous permettent d’écrire et de lire ces lignes.
Bref, nos déchets ne concernent pas que nos poubelles.
Ce que sous-tend l’objectif
Nous comprenons que l’objectif « zéro déchet » s’entend plus précisément comme l’objectif que nos déchets aient une incidence globale nulle sur notre environnement. Après tout, tous les êtres vivants produisent des déchets. Mais, dans des écosystèmes équilibrés, ces déchets n’ont pas d’incidence négative. Un peu comme du temps de nos aïeux, peut-être, avant l’exploitation des hydrocarbures et le développement de matières polluantes.
Ces incidences de nos déchets, on en identifie à toutes les étapes de la vie des matières: extraction, transport, transformation, commercialisation, utilisation, collecte, recyclage…
À toutes ces étapes, la première incidence concerne les besoins en énergie, nécessaire partout. Or, on a aujourd’hui une énergie essentiellement fossile ou nucléaire. Leurs ressources sont limitées, et dépendent d’autres endroits du monde avec lesquels nous sommes forcés d’être conciliants quant à leurs propres pratiques. Par ailleurs, les incidences de ces sources d’énergie sont lourdes en termes de risque à long terme (radioactivité) et de changement climatique (CO2).
Bref, puisque la première incidence de nos déchets concerne l’énergie, alors il serait pertinent d’élargir l’objectif de réduction à toutes nos activités énergivores.
Parmi les principales incidences de nos déchets, on pense aussi aux pollutions susceptibles d’être causées par nos déchets. Pollution des eaux souterraines, des rivières, de nos mers, de l’air, des sols… Or, concernant les déchets de nos poubelles, les filières régulières de gestion de nos déchets sont supposées maîtriser ces risques de pollution. Les pollutions liées aux déchets sont donc vraisemblablement le fait d’éliminations incontrôlées. Absence de filières d’élimination, déversements sauvages ou accidentels, usure des pneumatiques et des fibres de vêtements synthétiques, négligences,… Que ces éliminations hors filières soient intentionnelles ou non, l’injonction du « zéro déchet » n’a là aucune oreille pour l’entendre.
Pour nos responsables publics chargés de la gestion des déchets, la signification du « zéro déchet » n’est pas la même que ce que l’on en perçoit. Leur premier objectif est d’abord de réduire les coûts de gestion, tant financiers que fonciers. Les autres incidences de nos existences ne sont pas directement de leur compétence. Au contraire, limiter le message au seul mot « déchet » évite une contradiction pourtant évidente avec les messages émis par ailleurs visant notamment à consommer et se développer davantage. Le message porté se focalise donc sur un volume de déchets au lieu d’être plus global.
Des déchets à assumer, des déchets obligés, et des déchets sans incidence
Afin de réduire de manière responsable nos quantités de déchets, il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des déchets induits par notre existence, et pas uniquement ceux que l’on dépose chacun dans sa poubelle.
Afin de réduire nos quantités de déchets, il faut aussi parfois contrevenir à certains codes de vie en société. Refuser des « cadeaux », éviter l’inutile, refuser l’emballage, viser l’essentiel.
À côté de cela, l’incidence environnementale des déchets est variable selon les matières et les contextes. Certains déchets peuvent même ne pas avoir d’incidence négative.
– Des déchets à assumer
Hors de chez soi, le volume de déchets liés à des activités qui nous sont destinées est considérable. En 2009, l’ADEME rapporte que les déchets ménagers en France représentent 40 millions de tonnes, sur un total national de 770 millions de tonnes. Ce qui sort de nos habitations ne représente donc qu’un vingtième du total produit. Produire notre électricité, construire et rénover nos logements, moudre notre farine, nous vendre nos vêtements, distribuer notre eau potable, aménager nos rues, nous administrer… Si chaque acteur assume normalement la gestion des déchets que son activité produit pour nous, nous en somme toutefois chacun les premiers responsables. Face à ces volumes, peser le contenu de notre poubelle perd une bonne part de son sens.
Aussi, nous remplissons parfois nos poubelles de déchets provenant d’autres que nous. Hérités d’un temps de transition entre l’accroissement des volumes et la prise de conscience des conséquences, quand les déchets étaient enfouis ou partiellement brulés dans un coin de terrain. Ou, encore aujourd’hui, rejetés n’importe où, par commodité ou par négligence. Le « #Trashtag challenge » n’est-il pas un exemple à suivre pour remplir nos poubelles?

Plus gênant, il peut y avoir des déchets supplémentaires induits par notre souhait même de moins en émettre. Je pense au cas de la vente en vrac. Plutôt qu’être livrés en petits contenants légers ouverts à la maison, les produits sont livrés aux commerces en gros contenants, plus solides, plus épais. En effet, la quantité de matière nécessaire pour emballer du gros peut être plus importante proportionnellement que pour emballer du petit, à l’image du rayon de cire chez les abeilles. Pourtant, il faut bien l’assumer: les déchets que doit gérer mon commerce sont aussi mes déchets.

Ajoutons ce que l’on donne pour se débarrasser, en vue d’être réutilisé par d’autres. Des vêtements, des objets inutilisés, etc. Une partie de ce que je donne ne sera pas utilisé. Et dans tous les cas, tout finira par être jeté par d’autres.
Ajoutons aussi ce que l’on donne, sans même vouloir se débarrasser, mais dont nous connaissons ou pourrions anticiper la proche destinée comme déchet: les emballages des choses offertes, ainsi que les cadeaux inutiles ou éphémères.
– Des déchets obligés
Il y a encore peu de temps, refuser un sac plastique dans certaines boutiques était mal perçu, voire interdit (expérience personnelle).
L’incitation à l’achat de bricoles inutiles mais pas chères nous amène aussi à recevoir en cadeaux des trucs insensés que l’on aimerait refuser. Ce qui reste toujours compliqué, et implique que vider notre poubelle passe aussi par notre capacité à communiquer notre conviction, quitte à passer pour des pénibles.
Sans développer le cas de tous les emballages et autres trucs dérisoires que l’on acquiert soi-même sans bien se maîtriser.
– Des incidences inégales
Collecter des déchets abandonnés, susceptibles de générer des pollutions, pour les orienter vers des filières de traitement maîtrisées? Remplir nos poubelles de ce type de déchets doit être encouragé.
Mettre mon verre au recyclage? L’action semble bonne, ou au moins neutre. Pourtant, recycler consomme beaucoup d’énergie. En particulier le verre, l’acier et l’aluminium, qui doivent être fortement chauffés. Ceci dit, pour ces 3 matières le recyclage nécessite quand-même moins d’énergie que la production depuis le minerai.
Mal stockés, des déchets verts peuvent causer des pollutions des eaux (nitrates), des sols (asphyxie), de l’air (méthane, gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2)… À l’inverse, bien réutilisés, ces mêmes déchets verts peuvent soutenir une biodiversité, éviter le recours à des amendements ou fertilisants venus d’ailleurs, remplacer des combustibles fossiles pour le chauffage.
Parenthèse concernant le plastique: est-il toujours préférable de l’éviter? Pour transporter nos repas, une boîte en verre lourde et cassante est-elle plus durable? Pour emballer un aliment, à défaut de solution réutilisable, à résistance égale un film plastique ne nécessite-t-il pas moins d’énergie à produire/éliminer que de l’aluminium? Concernant le fait maison, 1000 fours individuels cuisant chacun 20 biscuits consomment-ils vraiment moins que la mutualisation industrielle de moyens en produisant en une cuisson 20.000 biscuits, emballage inclus? Des couches lavables sont-elles pertinentes si elles sont assorties d’un sèche-linge énergivore? Les évidences n’en sont pas toujours, mais les calculs ne sont pas aisés.
Bref, l’objectif de réduction des volumes de déchets doit tenir compte des incidences de ces déchets. Orientés vers une filière de traitement adaptée ou correctement réutilisés, certains déchets peuvent même avoir une incidence positive sur notre environnement.
L’avenir de notre énergie
De l’énergie, on en a besoin partout. Notamment à toutes les étapes de vie de nos matières et de nos déchets. Viser un « zéro énergie » n’est pas possible.
En revanche, on sait produire/exploiter des énergies illimitées, locales, (solaire, éolienne, hydraulique, musculaire…) sans les incidences lourdes de nos principales sources actuelles (combustibles fossiles et énergie nucléaire).
L’incidence de nos activités dépend donc directement de la quantité et de l’origine de l’énergie qui leur est nécessaire.
Concernant les déchets, le terme d’économie « circulaire » [2], suggère que l’on pourrait se passer de nouvelles matières par récupération de matières déjà utilisées, via le recyclage. Par opposition à notre développement actuel suivant essentiellement une économie linéaire: extraire – produire – consommer – jeter. En termes d’énergies, viser une économie circulaire n’a vraiment de sens que si la source d’énergie, nécessaire à chaque étape, n’a elle-même pas d’incidence.
En conséquence, réduire notre incidence négative liée à nos déchets, c’est réduire les quantités, bien-sûr, mais c’est aussi miser totalement sur les énergies propres.
Entre parenthèses, la ressource en eau est elle-aussi très dépendante de l’énergie. Notamment, avec de l’énergie, l’eau potable peut être abondante en dessalant l’eau de mer. Ainsi, dans ce domaine aussi, réduire des quantités consommées n’a vraiment de sens que si l’on mise sur des énergies propres.
Vers une économie circulaire?
Ce qui est nommé économie « circulaire » n’est pas circulaire comme le terme choisi le laisse entendre. Ni circulaire comme la représentation visuelle faite par l’ADEME sur le diagramme suivant le laisse comprendre.

L’économie « circulaire » vise une augmentation de l’exploitation de ressources durables, pas la fin de l’exploitation des ressources non durables. Elle vise un allongement de la durabilité des usages, pas la fin des poubelles. Elle vise une augmentation des recyclages, sans prétendre à la disparition des déchets non valorisables.
Sur le diagramme, la seule passerelle entre la partie déchets et la partie ressources concerne les quelques filières d’un recyclage loin d’être généralisable.
En effet, le recyclage ne concerne pas toutes les matières ou mélanges de matières. De plus, les rendements sont variables selon les matières et ne sont jamais parfaits. Le nombre de cycles est généralement limité, par exemple avec les fibres de papier. Parfois même, on parle de recyclage pour indiquer qu’une seconde vie sera donné à tel matériau, après laquelle il ne pourra plus être récupéré. Par exemple, les fibres textiles recyclées en rembourrages de carrosseries. Notons au passage que les mots « recyclable » et « recyclé » sont utilisés comme gages de respectabilité, mais ils sont souvent mal compris. Ainsi, le recyclage ne correspond jamais à cette boucle infinie du petit logo que l’on a pourtant en tête.

Ce qui est nommé économie « circulaire » est en fait basé sur le modèle linéaire actuel pour lequel est proposé un ensemble de pistes d’amélioration, sans toutefois porter le changement radical et nouveau qu’elle suggère. En fait l’ADEME propose ici une représentation plus honnête de ce que pourrait être une économie « circulaire »:

Sur cette nouvelle représentation, le schéma linéaire est conservé. L’ampleur des réemplois/recyclage est tout de même surdimensionné et les parties « extraction des matières premières » et « déchets non valorisés » mériteraient d’être davantage soulignées afin de ne pas masquer leur part irréductible. La mention « le recyclage ne suffira pas » devrait être chiffrée et représentée proportionnellement sur le diagramme afin d’être bien perçue.
Sur cette présentation toutefois, la soi-disant nouveauté des comportements est contestable. Avant l’apparition du plastique, les emballages de papier journal n’étaient-ils pas une forme d’éco-conception? Avant l’apparition du béton, le bois et le torchis n’étaient-ils pas des éco-matériaux? L’entretien, la réparation et le prêt des objets, ne sont-ils pas juste des pratiques un peu oubliées par les incitations modernes à surconsommer? Composter, n’est-ce pas déjà une évidence pour la plupart de ceux qui ont assez d’espace pour le faire? Revendre ce qui ne sert plus n’a-t-il pas toujours existé?
On nous propose un modèle comme solution d’avenir alors qu’il s’agit de mettre en avant des pratiques certes nécessaires mais déjà largement en place sans qu’elles soient suffisantes pour changer le modèle global.
Une conséquence malheureuse de l’économie « circulaire » et de ses représentations, c’est qu’elles font croire à une solution globale qui suffirait pour une gestion viable de nos ressources et de nos déchets. Elles confortent des pratiques molles de décideurs ainsi satisfaits.
Or, la dénomination « économie circulaire » et ses représentations ne correspondent pas à la réalité qu’elle décrit. Elles omettent les ressources non durables toujours nécessaire, les déchets non valorisables toujours éliminés et les besoins en énergie. Ainsi, elles occultent le premier impératif qui est de réduire nos consommations.
Autrement dit, il faudrait changer le terme « économie circulaire » par « moins acheter et moins produire ». Les pistes d’actions recensées seraient toujours applicables. Mais cet honnête impératif n’est pas supportable par nos décideurs retranchés derrière des diagrammes bien ronds et colorés.
Une incitation contradictoire
Nous avons vu que, pour nos responsables publics chargés de la gestion des déchets, inciter à réduire les volumes de déchets a d’abord pour objectif de réduire les coûts de gestion. L’objectif perçu, sensiblement différent, est une incitation à faire quelque chose de bien pour l’environnement. Cet objectif perçu est d’ailleurs utilisé pour donner une image positive des institutions concernées.
Cependant, cet objectif perçu va directement à l’encontre des incitations à consommer, émis par les mêmes responsables vantant le développement de la consommation et de l’éphémère.
Car tout ce qu’on acquiert finit déchet. Mon dernier téléphone. Nos trampolines et nos piscines de jardin. Les bricoles pas chères. Les coups de cœur. La déco tendance. Les objets offerts…
Il est simplement tout à fait contradictoire de promouvoir l’acquisition tout en valorisant la réduction.
Des recommandations peu convaincantes
Les actions de réduction sont essentielles. Respecter les filières d’élimination (poubelles, tri, déchèteries…), favoriser le réemploi (couches lavables, réparations, etc.), réfléchir à nos consommations (emballages, viande, taille de nos logements…)…
Toutefois, rappelons que les poubelles de ménages, c’est un vingtième de toutes les poubelles nationales. Or, les incitations semblent ne viser que nous, citoyens.
Par ailleurs, les incitations témoignent souvent d’un retard évident en la matière de la part de ceux qui les émettent. Pour la planète, portez le verre au container! Réduisez vos poubelles grâce à ce composteur! Soyez malin, apportez votre sac pour faire vos courses! Astucieux: raccommodez vos chemises!
Alors certes, il peut être bon de rappeler pédagogiquement quelques notions de base. Toutefois, il est affligeant d’entendre ces lieux communs annoncés comme novateurs par des interlocuteurs naïfs mais convaincus de pouvoir aujourd’hui faire de nous des gens mieux, comme si eux-mêmes s’y mettaient à peine.
Bonnes questions
Tout comme l’argent gagné n’est pas un indicateur pertinent de nos réussites personnelles, car il ne reflète pas les incidences négatives de nos actions, l’observation de nos poubelles traduit mal notre incidence globale sur notre environnement.
Pour être cohérent, l’objectif « zéro déchet » doit être globalisé vers un objectif plus vaste d’avoir chacun une existence au moins neutre en termes d’incidences.
Cet objectif implique notamment d’assumer les déchets produits pour nous par d’autres, ainsi que les sources de l’énergie utilisée à tous les niveaux.
Ok, alors comment on s’organise?
Il n’y a pas grand-chose à attendre passivement des pouvoirs publics qui promeuvent une prospérité économique par la consommation comme condition essentielle au bien-être des électeurs.
Il n’y a pas grand chose non plus à attendre passivement des fabricants, car tant qu’une activité est légale et rentable, le marché sera toujours occupé, par eux ou par la concurrence.
Il n’y a donc que nos changements de comportements personnels: nos appels aux élus et nos choix individuels de consommation, qui ensemble peuvent infléchir des décisions politiques et des offres commerciales.
En effet, qui est responsable, lorsque des décideurs gèrent pour nous et que des fabricants font pour nous? Notre parole et nos choix individuels sont les seuls moteurs pertinents du changement. En corollaire, notre silence et notre inaction, notre passivité en d’autres termes, voire notre dépit face à un monde qui nous échapperait, sont les premiers coupables de l’inertie d’un modèle sans issue.
Bougeons-nous. Le monde nous appartient.
[1] Définition légale: est appelé déchet « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » (loi cadre du 15 juillet 1975, et art. L.541-1-II du Code de l’Environnement)
[2] La Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a entériné la volonté collective des parties prenantes d’engager la France dans une transition vers l’économie circulaire : dans un contexte de rareté croissante des ressources, d’enjeux sur l’approvisionnement énergétique de la nation et le changement climatique, dans l’objectif de sortir du modèle classique « linéaire » de production et de consommation (extraire, produire, consommer, jeter) (source ADEME)
.
.
.