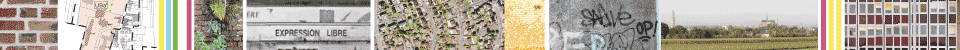L’ABEILLE NOIRE, comme toutes les abeilles, comme tous les êtres vivants non domestiques, est le fruit de l’évolution naturelle, par laquelle les individus génétiquement les plus adaptés à leurs conditions de vie transmettent ces caractères à leur descendance. Leur variabilité génétique est garante d’une adaptation efficace aux variations de l’environnement.
L’abeille noire, c’est celle dont nos aïeux pas si lointains peuplaient leurs ruches. Puis, les apiculteurs ont préféré mettre en ruche des abeilles venues d’ailleurs. Des italiennes, des caucasiennes, etc., de la même espèce, mais aux caractères génétiques adaptés à d’autres environnements. Les apiculteurs en ont multiplié les variétés les plus productives, et les plus adaptées à une industrialisation de la pratique. Quitte à les nourrir de sucre industriel, à les traiter systématiquement ou encore à renouveler chaque année les colonies.
Or, les abeilles mellifères, ça ne se féconde pas comme une vache, dans l’intimité d’une insémination contrôlée à la ferme [1]. Chez les abeilles, la reine vierge s’envole par une belle journée, puis revient à la ruche fécondée par une quinzaine de mâles des environs.
Dans ce contexte, nos abeilles noires perdent à grande vitesse leur diversité génétique initiale, par hybridation avec ces allochtones sélectionnées issues d’élevages.
Si l’abeille domestique n’est pas menacée en effectifs, car elle est sans cesse reproduite par l’apiculture, elle l’est en revanche en qualité génétique. Remplacez les loups par des caniches, de la même espèce, ou les sangliers par nos obèses porcs roses, de la même espèce, et vous n’en entendrez plus parler tant ils disparaîtront vite par incompatibilité et inadaptabilité à leur environnement.
D’ailleurs, pour être précis, il existe autant d’abeilles noires que de régions – on utilise le terme d’écotypes – voire autant d’abeilles noires que de colonies. Bref, dans la nature, les évolutions se font en fonction des environnements locaux.
Quoiqu’il en soit, l’abeille noire doit être protégée, dans son état naturel, comme tout être vivant sauvage maillon de nos écosystèmes.
Ainsi, ces dernières années, quelques voix tentent de plaider pour elles. Parmi ces voix, il y a celle de M. Garnery, chercheur au CNRS, spécialiste de la génétique de l’abeille.
Avec d’autres, M. Garnery soutient le développement de sites conservatoires de l’abeille noire. Il s’agit de secteurs géographiques uniquement peuplés d’abeilles noires, dans lesquels les reines peuvent être fécondées sans risque de croisement avec des mâles d’autres variétés. Plusieurs de ces conservatoires existent ou sont en projet en métropole, mais doivent composer avec des apiculteurs locaux à convaincre. Ils nécessitent aussi des soutiens financiers pour se développer, et un soutien politique fort pour être pérennisés.
Or, parmi les soutiens financiers, le plus visible est celui de pollinis, structure hyper communicante sur internet, convaincante, mais historiquement contestable et encore récemment contestée, pour des raisons plausibles [2]. À mes yeux, ce soutien est très pénalisant pour la crédibilité de la démarche, notamment auprès des politiques dont un soutien plus important serait pourtant précieux. Pour apporter un crédit complémentaire à la conservation de l’abeille noire, on peut donc aussi regarder côté belge, où l’association Mellifica ABSL travaille dans le même sens.
Second handicap: les débats sur les races d’abeille sont largement dominés par les apiculteurs eux-mêmes, dont les professionnels sont les premiers porte-voix. Or, pour la seule production de miel, il est reconnu que d’autres variétés que l’abeille noire peuvent être plus productives. Et, pour un apiculteur qui vit de sa production, comme pour tout professionnel, chercher le rendement est légitime. Dans le milieu, l’abeille noire est décrite telle une variété de poireaux que l’on choisirait dans un catalogue. Une variété assez médiocre selon les critères propres à l’apiculture, qui lui en préfère d’autres. Au mieux, lit-on parfois que l’abeille noire est susceptible d’apporter de nouveaux caractères intéressant pour l’optimisation des abeilles d’élevage, et qu’il serait dommage à ce titre qu’elle disparaisse.
En conséquence, pour protéger l’abeille noire, il faut lui réserver des zones dédiées, accepter des soutiens même s’ils sont discutables, et entendre les voix autres que celle d’une profession dont la motivation légitime est sa propre réussite et non la préservation d’un patrimoine naturel.
[1] En fait si, l’insémination artificielle est parfois pratiquée chez l’abeille, mais elle reste marginale
[2] Deux liens sur le cas pollinis : historique utile ; article de Que Choisir
.
.