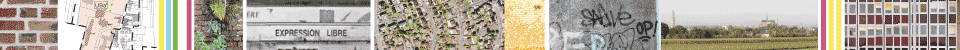Une vidéo contre l’éolien, en ligne sur youtube depuis juin 2021, dénonce tous les travers de cette source d’énergie.
Soutenue sans nuance par la plupart des commentaires, nombreux, mais relayant de fausses informations et des images trompeuses, omettant de relever que toute source d’énergie a sa part d’inconvénients, j’ai rédigé mes propres observations.

Éoliennes : du rêve aux réalités
Bonjour,
Être mise en ligne sur internet ne fait pas d’une vidéo une vérité, fut-elle réalisée de manière professionnelle comme celle-ci, fut-elle « offerte » gratuitement à qui veut la regarder, fut-elle relayée par des médias nationaux (le Figaro, le Point).
Un problème de cette vidéo, c’est qu’elle associe des faits reconnus, des commentaires pertinents, à des éléments de confusion, et à des critiques portées uniquement sur l’éolien alors qu’elle pourraient aussi être étendues à ses alternatives. Car si la contestation de l’éolien est facile, elle l’est aussi des autres sources d’énergie, considérées chacune indépendamment des autres. L’honnêteté voudrait qu’une vue d’ensemble soit proposée afin d’assumer en responsabilité notre alimentation en énergies, sans se contenter d’alimenter une contestation ciblée.
Parmi les éléments de confusion, la vidéo relève que c’est surtout en France, avec ses centrales nucléaires, que l’éolien n’a pas d’intérêt pour décarboner l’énergie. On suppose donc que la suite de la vidéo s’intéresse à l’éolien en France. Or, les images présentées les plus anxiogènes proviennent d’autres pays, notamment:
– celles qui montrent des éoliennes avec des bandes colorées (45:00 par exemple),
– celles d’un ancien champ d’éoliennes très nombreuses (0:47, 39:37, 39:39),
– celles d’un champ d’éoliennes abandonnées (1:24:38), en illustration de la question du démantèlement,
– celles d’un enfouissement de pales (1:21:07)
Comment qualifie-t-on des images qui ne se rapportent pas aux commentaires qu’elles sont supposées illustrer?
Le débat sur les énergies est nécessaire. Mais, en quoi l’intention moqueuse exprimée en retenant Nicolas Hulot qui bafouille, Mme Merkel zoomée s’amusant sur un moulinet et M. Hollande coupant le passage à Mme Merkel, alimente-t-elle le débat? Et les musiques angoissantes, et les images prises hors contexte? En rien. Au contraire: plutôt que d’y contribuer factuellement, ces éléments alimentent un rejet uniquement ressenti. Or, n’est-ce pas ce qui est justement reproché aux anti-nucléaire, de s’opposer essentiellement sur un ressenti?
Quelque part, le commentaire accuse les promoteurs de l’éolien de s’approprier eux-même des termes qui leur sont favorables: « parc », « champ », « ferme ». La vidéo ne fait-elle pas de même en se qualifiant elle-même de « documentaire », annonçant elle-même en titre révéler les « réalités », et émaner d’une « association »? Le choix des mots fait beaucoup, chacun le sait.
Parmi les commentaires faux entendus dans la vidéo, je note en particulier:
47:11 « L’Ademe a discrètement reconnu que le nucléaire émet 2 x moins de CO2 que les éoliennes » Était-ce caché? Non. L’annonce est-elle discrète? Non plus. M. Jancovici lui-même, qui a développé une méthode de bilan carbone, citait en 2003 cette donnée de l’ADEME, reprise dans tous les documents de référence sur le sujet à quelques nuances près https://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/bilan-carbone/
12:32 « Ceux qui en profitent ne parlent jamais en KWh produits » C’est faux. Les études d’impact, publiques, de même bien-sûr que les calculs de rentabilité des projets, se basent sur l’énergie produite annuellement, tenant compte des temps de fonctionnement en équivalent pleine puissance. Ce qui est vrai en revanche, c’est que la différence entre puissance installée et énergie produite est souvent mal comprise par les décideurs et par les commentateurs. Il est vrai aussi que ça n’a pas de sens de comparer des puissances installées de moyens de production différents, y compris pour l’énergie nucléaire (fonctionnement moyen à 70% de la capacité installée, avec 380TWh produits en 2019 pour 60 GW installés).
1:22:10 éolien: « la nacelle contient un alternateur à aimants permanents, contenant 200 kg de terres rares » C’est largement faux: cela ne concerne que 6,2% des éoliennes installées en France (Ademe, avis technique « terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie », oct. 2020), bien que cette part pourrait augmenter avec l’éolien offshore.
1:21:00 « Certains sont conduits à enterrer secrètement les pales ». Cette accusation n’est pas justifiée, tandis que la vidéo montre des images connues d’enfouissement aux USA, et qu’en France le développement de l’éolien est encore trop récent pour que le problème soit encore réellement posé. Ici, pas d’enfouissements de pales à l’horizon, bien que, après incinération, les résidus d’incinération puissent eux être enfouis, comme c’est le cas pour les coques des bateaux, de même composition, et plus généralement pour tous nos déchets voués à l’incinération. Ce que l’on pourrait utilement mettre en parallèle avec la gestion des déchets nucléaires. Autant de sujets sur lesquels il serait bon que chacun de nous ait quelques connaissances, afin d’assumer pleinement nos choix.
47:23 La vidéo omet d’indiquer que la décarbonation de l’énergie ne s’arrête pas à notre fourniture actuelle d’électricité, déjà décarbonée à 90%, comme si aucun effort supplémentaire ne se justifiait. Les transport et le chauffage, c’est de l’énergie fossile, qui concerne près de 2/3 de notre consommation globale d’énergie. Leur nécessaire décarbonation passera essentiellement par un accroissement de nos moyens de production d’électricité. La question n’est donc pas aujourd’hui de supprimer des centrales nucléaires au profit de l’éolien, bien que ce soit à celle-là que la vidéo réponde, négativement. Les questions qui se posent sont notamment: faut-il passer en tout électrique? Faut-il donc tripler le parc nucléaire? Le risque nucléaire doit-il être accepté? Nos ressources en uranium sont-elles illimitées? Comment massivement isoler? Comment massivement réduire les puissances de nos véhicules? Sera-t-il techniquement possible de stocker l’énergie de manière abordable et suffisante?
Enfin, la France, c’est petit. En Europe, où le libre échange est un principe de base, faut-il bouder une création d’emplois hors de nos frontières pour la seule raison que jusque là, le nucléaire nous fournit des emplois très français? Et, au niveau mondial, l’éolien, moche ou pas moche, c’est essentiel pour réduire les consommations de ressources fossiles. Sauf à considérer qu’il faille nucléariser tous les recoins de la planète.
Réponse des réalisateurs :
Merci d’avoir pris le temps d’écrire un si long commentaire David.
Pour les images ne venant pas de France vous devez prendre en compte que le film souligne des réalités existantes de l’éolien, qui si elles ne sont pas encore toutes avérées en France (pays qui a du ‘retard’ comme disent nos dirigeants) pourraient le devenir si rien n’est fait. Il y a donc matière à alerter sur ces aspects, même en traitant le sujet sous le prisme national.
Votre terme de ‘commentaires faux’ est lui-même exagéré. Même si nous convenions de vous donner raison, il s’agirait de nuances tout au plus – et non de mensonges. Vous souligniez plus haut le rôle des mots, tachons donc de les respecter.
A bientôt.
Réponse de ma part :
Bonjour, une déclaration fausse, erronée ou incomplète (le choix d’un mot n’est pas toujours parfaitement réfléchi dans un commentaire de vidéo) n’est pas nécessairement un mensonge, bien-sûr.
Reconnaissons effectivement que, de toutes parts, les erreurs et omissions sont souvent commises de bonne foi. À chacun de nous, de bonne volonté, par l’échange, de prendre le temps de rechercher la vérité, dans le souci, au fond, de parvenir à un modèle de vie commune honnêtement durable.
.
En 2022, soit un an après ce premier documentaire sur l’éolien, le réalisateur a signé un nouveau documentaire : le nucléaire : une énergie qui dérange.
Celui-ci répond à plusieurs questions que j’avais soulevées, et semble plus rigoureux, bien que très orienté.
Il lui manquerait ainsi :
- une description des risques liés aux usages du combustible dans des pays politiquement instables, qui constituent une limite a priori forte à une généralisation mondiale de cette source d’électricité,
- la mention du temps long nécessaire à son développement, incompatible avec un usage transitoire face à l’urgence climatique,
- la mention qu’il ne pourrait solutionner qu’une faible partie du problème climatique, l’essentiel des émissions de CO2 provenant d’usages non électrifiés,
- l’évocation d’une sobriété énergétique, qui permettrait d’éviter une partie des constructions que l’on pense aujourd’hui nécessaires avec les inconvénients liés.