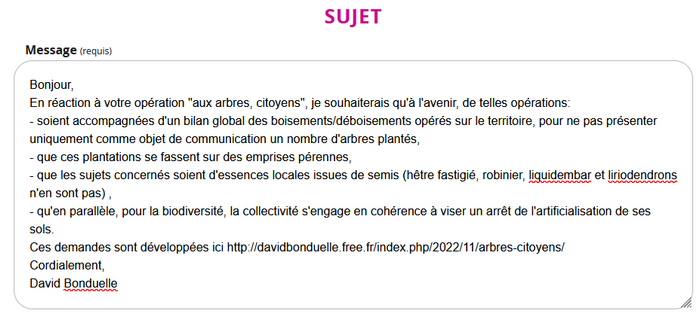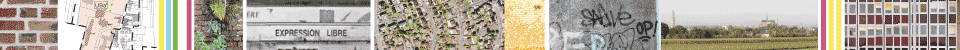Pour un clic, une naissance, voire pour sauver le climat, ou simplement donner bonne conscience à peu de frais… « planter un arbre » est une mesure servie à toutes les sauces de belles images mais qui, sans mise en contexte, ne veut absolument rien dire.
Pire, faute de cacher de riches forêts, les arbre médiatisés détournent souvent l’attention d’autres opérations dont le bilan négatif sur la biodiversité n’est pas pris en compte.
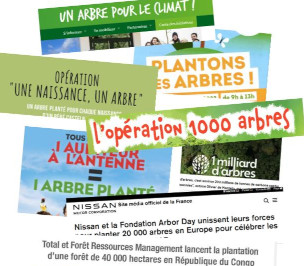
1. Un bilan global
D’abord, si l’on communiquait honnêtement sur des arbres plantés, il faudrait aussi détailler les arbres supprimés et les parcelles défrichées sur le territoire concerné, ou par les promoteurs mêmes du projet de plantation, puis afficher un bilan global.
À Amiens par exemple, tandis que la ville communique en novembre 2022 sur les 350 arbres qu’elle offre sur une idée émanant du budget participatif, l’étude d’impact du projet d’extension de la ZAC Jules Verne annonce la même année la suppression d’un boisement existant de 6000 m2.
Autre exemple amiénois, tandis que « 1500 autres essences (sic) s’épanouiront dans les jardins familiaux« , plusieurs hectares de jardins boisés ont été rasés pour laisser place à l’extension de la ZAC Paul Claudel.
Un bilan global serait certainement publié s’il était favorable à nos décideurs. À l’inverse, la seule mention des arbres plantés lors d’une telle opération suggère très sérieusement un bilan défavorable.
2. Une emprise foncière
Un autre point souvent omis de ces opérations concerne l’emprise foncière de l’arbre planté. Car un arbre sans foncier protégé n’a pas d’avenir assuré. Et, pour qu’un arbre constitue un soutien réel à la biodiversité et qu’il intervienne de manière effective dans le cycle de l’eau notamment, plusieurs décennies de croissance et d’enracinement sont nécessaires.

Mais un arbre nu ne coûte rien (exemple ici, avec l’opération « plantons le décor », 75 € TTC le lot de 100 sujets en mélange champêtre), tandis que le terrain coûte cher. Si bien qu’une mesure de plantation d’arbres, si elle constitue d’abord un support de communication à moindre frais pour son promoteur, se contente généralement de compter les sujets plantés. Tout en privant les jardineries d’une partie de leur clientèle lorsque l’opération vise à offrir des arbres à des particuliers.
Ainsi, ce sont des surfaces boisées qu’il faudrait annoncer, plutôt qu’un nombre de sujets. Car ces surfaces boisées sont identifiables, peuvent être protégées, et leur évolution est quantifiable, contrairement à des sujets disséminés.
3. Une flore locale
Concernant les espèces à retenir, si le peuplier d’Italie, le platane et le marronniers sont familiers de nos villes, ce ne sont pas pour autant des espèces locales. Or, ce sont d’abord les essences locales qui constituent le support de la biodiversité dans un lieu donné, ayant coévolué au cours des siècles passés.
Alors certes, les espèces exotiques ne sont pas toutes invasives comme le buddléia et la renouée du Japon, communes à Amiens, ni toxiques pour la faune locale comme l’est pour les abeilles le tilleul argenté planté à la citadelle. Toutefois, les espèces exotiques n’étant pas adaptées à nos écosystèmes locaux, ce sont toujours des essences locales qui devraient être proposées à la plantation, en particulier dans nos aménagements publics.

Par ailleurs, pour la biodiversité, une diversité d’essences est nécessaire dans un même boisement. À l’extrême inverse, une plantation industrielle d’arbres en monoculture a une diversité biologique très limitée.
Plus encore, la biodiversité ne s’arrêtant pas à l’échelle de l’espèce, et la variété génétique au sein d’une même espèce étant déterminante pour assurer la stabilité de ses populations, les plants retenus devraient être eux-même issus de graines récoltées localement.
Au passage, soulignons que les variétés horticoles, (ornementales ou fruitières), sélectionnés par l’homme, si elles peuvent présenter des intérêts incontestés pour la ressource alimentaire, les échanges sociaux ou le patrimoine gustatif, ne constituent plus, tout comme nos poules, vaches et cochons domestiqués, des éléments à part entière de nos écosystèmes.
À ce propos, déplorons qu’Amiens, dans le cadre de son opération actuelle, propose de telles variétés horticoles (hêtre fastigié), exotiques (liquidambar, liriodendron), ainsi que le robinier faux-acacia, une espèce considérée comme invasive notamment à Amiens dans le site Natura 2000 de la vallée de la Somme qui la traverse (Docob p.294) et dans la région voisine d’Ile de France. Certes, le règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Amiens reste évasif sur ces questions, alors que les PLU proposent généralement une palette de flore locale recommandée. Toutefois, l’importance d’un recours à une flore locale est soulignée dans d’autres pièces du PLU d’Amiens, notamment dans son rapport de présentation.
En revanche, comme le fait le règlement du PLU en réduisant souvent la végétation à son seul rôle de masquage : « des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations diverses », les opérations de plantation d’arbres pourraient bien ne viser qu’à masquer à l’opinion publique la faible prise en compte globale de la biodiversité dans les projets actuels et à venir.

4. Des milieux non artificialisés
Un bilan global, une emprise pérenne, des essences locales et variées… Est-ce désormais satisfaisant ?
Pas encore. Car des espèces locales d’arbres, on en compte quelques dizaines. Ces arbres constituent un support important pour la biodiversité là où ils se trouvent, certes, mais ils ne constituent qu’une part infime de cette diversité. Par ailleurs, on trouve aussi des milieux potentiellement riches en biodiversité qui ne sont pas boisés, avec notamment, autour d’Amiens, des friches, des prairies et des terres cultivées.
Un bilan global des gains et pertes de biodiversité doit aussi inclure ces autres milieux non boisés. Or, des terres cultivées d’Amiens et de sa métropole sont encore aujourd’hui artificialisées par nos décideurs (ZAC boréalia, Jules Verne, habitat à Camon), sans que la perte de biodiversité associée ne soit mise en parallèle avec les arbres plantés par ailleurs.
Pour la biodiversité, il faut donc d’abord conserver les milieux qui lui sont déjà favorables, que ce soient les milieux naturels anciens et équilibrés, mais aussi l’ensemble des milieux non artificialisés. Il s’agit là de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, inscrit dans la loi « climat et résilience » en août 2021. Cet objectif est nécessaire pour atteindre enfin un équilibre entre activités humaines et « ressources planétaires ». Pourtant, tandis que l’on est encore loin d’atteindre cet objectif, les décideurs amiénois ne montrent aucune volonté de se l’approprier. D’ailleurs, s’il était atteint, l’objectif du seul statu quo ne serait pas suffisant : pour pallier les pertes de biodiversité, y compris les pertes non maîtrisées, il est nécessaire aussi de donner de l’emprise à l’extension des milieux existants et à de nouveaux milieux, idéalement par colonisation spontanée par les espèces locales, éventuellement contrôlée a minima pour éviter l’expansion des espèces invasives. Puis de leur assurer une pérennité solide.
5. En synthèse, exigeons
En synthèse, pour toute opération de plantations d’arbres, exigeons :
- ☐ un bilan global, honnête, des pertes et des gains sur le territoire concerné,
- ☐ la définition d’emprises pérennes,
- ☐ des essences locales, issues de semis,
- ☐ le maintien en parallèle des milieux naturels déjà établis et des milieux non artificialisés, ainsi que le développement de nouveaux espaces de nature
Sans mention de ces détails, il est vraisemblable qu’aucune des cases ne soit cochée. Que le bilan global des boisements et de la biodiversité en général soit déficitaire, que les emprises ne soient pas pérennes, que les sujets soient peu adaptés à la biodiversité locale, et que l’artificialisation des sols suive son cours en parallèle comme si de rien n’était.
6. Un bilan dont sont redevables nos décideurs
Petite digression pour souligner qu’il serait utile à la démocratie locale d’éviter de faire croire que les habitants sont exceptionnels d’avoir fait planter quelques arbres via un « budget participatif » alors que le bilan global des plantations sur le territoire dépend essentiellement du bon vouloir de nos décideurs publics.
7. Un effet négligeable sur le climat
Le site internet d’Amiens explique qu’un arbre « contribue à diminuer le taux de gaz carbonique« .
Rectifions d’abord : le taux atmosphérique de CO2 ne diminue pas, si l’information avait échappé à quelques-uns.
Ensuite, ce n’est que si un arbre est planté sur un terrain qui n’était pas boisé jusqu’alors, puis que ce terrain reste boisé indéfiniment, que cet arbre permet effectivement de stocker du carbone. Car, si en fin de vie cet arbre disparaît sans remplacement, le carbone qu’il a stocké dans son bois est réémis dans l’atmosphère. Au mieux, si le bois est brûlé pour le chauffage en substitution de ressources fossiles, on peut dire que l’arbre planté aura évité de nouvelles émissions de CO2, mais pas qu’il a contribué à en diminuer la concentration. Diminuer des émissions ne fait pas diminuer la concentration finale.
La protection pérenne d’un boisement, déjà nécessaire pour son soutien à la biodiversité, serait donc ici aussi essentielle, mais sur plusieurs siècles, pour lui conférer un rôle effectif pour le stockage de carbone. Or, miser sur une pérennisation de plantations boisées éparses – répartition que prennent a priori la plupart des opérations de plantations à visée promotionnelle – à aussi longue échéance, est illusoire.
Enfin, si l’on admet que des espaces boisés puissent être ainsi définis et maintenus, il est alors nécessaire de comparer la quantité de carbone stocké sur ces nouveaux espaces boisés avec les émissions de CO2 qu’il conviendrait de compenser. Prenons un exemple. Globalement, une tonne de bois (frais à 50 % d’eau) stocke l’équivalent d’une tonne de CO2. Supposons une ZAC avec 1000 poids-lourds quotidiens supplémentaires (ordres de grandeur de chacune des 2 ZAC en projet Boréalia et Jules Verne), avec un rayon d’influence de 50 km et une consommation de gasoil de 40 litres aux 100 km. Il faudrait ajouter un arbre adulte de 20 tonnes chaque jour pour stocker l’équivalent C02 émis par le seul trafic de poids-lourds généré par cette ZAC. Soit une forêt de 18 250 arbres après 50 ans. Ou 40 hectares de forêt amazonienne.
En fait, les émissions actuelles de CO2 dues aux combustibles fossiles sont simplement démesurées par rapport au carbone potentiellement stocké par quelques plantations. D’ailleurs, même en reboisant la France entière, on ne pourrait compenser que les émissions liées à la perte des forêts françaises, mais on ne pourra jamais compenser par des plantations l’équivalent du carbone que l’on a extrait et que l’on extrait encore, directement ou non, du sous-sol terrestre sous forme de charbon et d’hydrocarbures.
Pour le climat, l’arbre planté pour l’image est donc négligeable. L’impératif est connu mais occulté par de nombreux décideurs : il s’agit d’abord de stopper tout nouveau projet émetteur de CO2, au premier rang desquels, à Amiens Métropole, l’expansion urbaine par l’artificialisation des sols, induisant notamment une multiplication des transports motorisés.